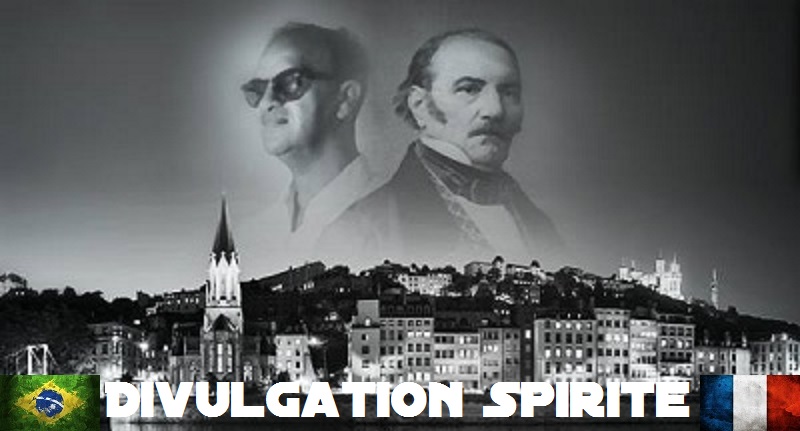Léon Denis : Socialisme et Spiritisme Léon Denis (1846-1927) fut un philosophe spirite et, aux côtés de Gabriel Delanne et Camille Flammarion, un des principaux continuateurs du spiritisme après le décès d’Allan Kardec. Il fit des conférences à travers toute l’Europe dans des congrès internationaux spirites et spiritualistes, défendant activement l’idée de la survie de l’âme et ses conséquences dans le domaine de l’éthique dans les relations humaines.
Léon Denis (1846-1927) fut un philosophe spirite et, aux côtés de Gabriel Delanne et Camille Flammarion, un des principaux continuateurs du spiritisme après le décès d’Allan Kardec. Il fit des conférences à travers toute l’Europe dans des congrès internationaux spirites et spiritualistes, défendant activement l’idée de la survie de l’âme et ses conséquences dans le domaine de l’éthique dans les relations humaines.(Extrait de L’Univers de la Parapsychologie et de l’Ésotérisme, Tome 2, éditions Martinsart, 1976)
« La mort n’est qu’un déplacement d’existence. » (
J. Jaurès).
Léon Denis nous parle de Jean Jores.LEON DENIS : - J’ai connu Jean Jaurès à Toulouse, dans le temps de sa jeunesse. Il était alors professeur à la Faculté de Lettres, adjoint au maire, chargé du service de l’enseignement et il habitait avec sa famille un modeste entresol, place Saint-Pantaléon.
En 1891, lorsque parut mon premier livre : Après la Mort, je lui en fis parvenir un exemplaire à Paris où, devenu député, il dirigeait le journal L’Humanité qu’il avait fondé. Le compte-rendu donné par cette feuille fut très favorable, et, par cet article, comme par nos entretiens précédents, je vis clairement que Jaurès penchait vers nos doctrines. Jean Jaurès était né en 1859, à Castres, c’est-à-dire au centre de ce pays des Albigeois, martyrs de la libre pensée et dont l’histoire est riche en scènes tragiques. Nous sommes là, dans ce Languedoc épris d’art, de poésie, de beauté, qui possédait une culture intellectuelle et une civilisation raffinée, alors que la France du nord était encore à demi-barbare. Jaurès, avec son éloquence imagée et son vaste génie, était comme une synthèse vivante, une personnification de cette race à la fois enthousiaste et pratique, formée par les courants ethniques les plus divers, fondus dans une unité harmonique. Dans tous ses discours et ses écrits, on retrouve cette aspiration ardente vers l’idéal, vers la liberté et la justice, caractéristique de cette race originale et féconde qui a produit tant d’hommes célèbres. Dois-je le dire, c’est au cours de réincarnations nombreuses que l’âme de Jaurès s’est enrichie des qualités, des facultés brillantes de ce pays. Son histoire fut la sienne, il a joui du rayonnement de sa pensée, il a souffert de ses maux, participé à ses épreuves, à ses douleurs, et s’est toujours inspiré de son génie. Moi-même, j’en ai ressenti l’ambiance dans les années de ma jeunesse passées en ce milieu et il me semble en avoir gardé l’empreinte. Du fond de la vallée de l’Aude, que j’habitais alors, je pouvais contempler les crêtes de la Montagne Noire et ce pays du Minervois que Pierre de Cabarède défendit héroïquement contre les farouches croisés. Que de souvenirs historiques ! Le sac de Béziers, la prise de la haute cité de Carcassonne et son vicomte Trencavel, chargé de chaînes et jeté dans une fosse, malgré la promesse formelle des chefs de la croisade. Puis le siège de Toulouse et cet épisode reproduit sur un panneau de la salle des Illustres, au Capitole : la baliste servie par des femmes d’où partit la pierre qui allait tuer Simon de Montfort. Lorsque, avec mes amis toulousains, nous passions en revue ces événements mémorables, je sentais leurs âmes frémir à l’évocation de ce passé qui vit l’asservissement de leur petite patrie sous le joug impitoyable de l’Église et des rois. Car la flamme couve toujours en eux sous la cendre des siècles évanouis.
Revenons à Jaurès ; chose rare chez un homme politique, son caractère était à la hauteur de son talent. Tous ses biographes s’accordent à lui reconnaître un naturel simple, droit, bienveillant pour tous, cordial pour les plus humbles. Son abord était facile, il s’échappait de sa personne comme une radiation de vérité, de sincérité, de bonhomie qui le rendait sympathique même à ses adversaires. Cependant, il savait se libérer des promiscuités, des vulgarités de son parti en se plongeant dans un labeur acharné, en élevant sa pensée vers les hautes sphères d’une philosophie large et sereine. Sans être un ascète, ses habitudes étaient des plus modestes et son intérieur peu dispendieux. La description que fit M. G. Téry de son cabinet de travail, ce « pigeonnier d’Auteuil », réduit à néant les calomnies de ses ennemis au sujet de son prétendu « luxe et de sa fortune ». La preuve est faite que Jaurès naquit et mourut pauvre. Quant à son talent oratoire, afin de donner une idée de l’impression qu’il produisait sur tous, nous citerons ces lignes d’un de ses auditeurs, qui fut aussi un témoin de sa vie : « Jaurès était l’orateur parfait, intégral ; même lorsqu’il improvise, il ne parle que de choses qu’il a étudiées à fond. Il s’adresse tout ensemble à la raison, aux sentiments et à l’oreille. Il est l’artiste doublé d’un savant et d’un homme d’État. Plein de vigueur et de passion, il se possède pleinement. Il ne dit que ce qu’il veut et doit dire. Les pensées se suivent et forment un tout harmonieux… C’est un véritable athlète de la tribune. Il crie, il tonne, il tempête, il empoigne, il emporte l’auditeur, mais il ne cesse pas, en même temps, de l’éclairer et de l’instruire. Malgré sa voix monotone qui n’a rien d’agréable, mais qui agit plutôt comme une force élémentaire, il ne cesse pas d’intéresser. On sent la solidité, la vérité de tout ce qu’il dit. Si le débit est sans variété et dépourvu d’artifice, le caractère du discours change à chaque instant. De claires et fines pensées alternent avec des images somptueuses ; tantôt elles paraissent descendre d’une grande hauteur, tantôt elles jettent une masse de lumière éblouissante sur des problèmes en apparence inextricables. On se sent en présence d’une force supérieure, d’une force de bonté et de clarté. Un courant d’amitié s’établit entre l’orateur et son auditoire. Et on sort meilleur de la salle où Jaurès vient de répandre les flots sonores et limpides de sa vigoureuse et saine éloquence. »
Après l’avoir entendu, on voudrait être l’ami, le frère de tout ce qui vit et souffre. On semble être revenu d’un voyage à travers un pays idéal d’éternelle beauté, d’éternelle justice. Presque toute la vie de Jaurès a été une lutte pour le socialisme. Sans doute, il a pu commettre des erreurs et parfois côtoyer l’utopie, mais nous ne croyons pas qu’il se soit jamais rangé du côté des communistes moscovites. Jaurès n’écrivit-il pas dans un article de la Petite République intitulé « Mes Raisons » : « Jamais je n’ai dit que le parti socialiste, maître de l’État, userait de violence dans l’État, pour abolir les traditions. Je n’ai jamais fait appel qu’à l’organisation graduelle de la liberté, qu’à la force intime de la science et de la raison » ? Voyons maintenant en Jaurès le philosophe, et recherchons dans son œuvre sur quels points nous pouvons nous rencontrer. Au premier abord, elle nous apparaît comme une sorte de panthéisme idéaliste où toutes les formes du spiritualisme se rejoignent, se fondent dans une vaste et puissante unité. C’est, du moins, ce qui se dégage de sa thèse, publiée sous le titre : La Réalité du Monde sensible. Mais cette thèse de sa jeunesse représente-t-elle la dernière pensée, la conception ultime de l’auteur ? Lui-même déclare : « Je n’ai pas la prétention puérile de n’avoir jamais changé en vingt années d’expérience, et je me garderai de dire que la vie ne m’a rien appris ». « À mesure qu’il avançait en âge, dit Lévy-Bruhl dans sa biographie, les problèmes philosophiques et religieux s’imposaient de plus en plus à son esprit ». Il disait à ses amis qu’il devait procéder par des suggestions de plus en plus nettes, avant d’aborder de front la question, dans un ouvrage direct qu’il réservait pour sa vieillesse. Loin de penser que le progrès social dût faire évanouir ces problèmes, il a écrit plus d’une fois que la société nouvelle, fondée sur la justice, verrait se produire « un grand renouvellement religieux ». Les formes religieuses actuelles disparaîtront, mais d’autres naîtront, car le sentiment et l’idée de l’infini sont indéracinables. « L’âme enfantine, dit Jaurès, est pleine d’infini flottant, et toute l’éducation doit tendre à donner un contour à cet infini qui est dans nos âmes. » Ces paroles démontrent avec évidence que, si Jaurès avait vécu, il nous aurait doté d’une œuvre philosophique magistrale, mais la politique socialiste l’a entièrement absorbé et une mort prématurée a fait obstacle à ses projets. Citons dans sa thèse ce qui mérite le plus de retenir notre attention : « Quand le socialisme aura triomphé, écrivait-il, les hommes comprendront mieux l’univers. Car, en voyant dans l’humanité le triomphe de la conscience et de l’esprit, ils sentiront bien vite que cet univers, dont l’humanité est sortie, ne peut pas être, dans son fond, brutal et aveugle, qu’il y a de l’esprit partout, de l’âme partout, et que l’univers lui-même n’est qu’une immense aspiration vers l’ordre, la beauté, la liberté et la bonté. »
Jean Jaurès, par ses conceptions philosophiques, se classe donc dans la grande école idéaliste et spiritualiste qui va de Platon à Bergson et aboutit, par la force et la logique même des choses, à la doctrine des Esprits. « Le besoin de l’unité, écrivait-il, est le plus profond et le plus noble de l’esprit humain. Tout moment de la durée retentit à l’infini dans les moments ultérieurs, et l’Esprit, en franchissant les siècles d’un bond, retrouve la suite intelligible de ce qu’il a quitté. Il n’y a pas de solution entre la vie et la mort… L’univers est une grande société de forces et d’âmes qui, sollicitées entre le bien et le mal, aspirent, du fond des contradictions et des misères, à la plénitude et à l’harmonie de la vie divine. » Il est évident que Jaurès avait l’intuition des existences successives de l’âme, car cette plénitude ne saurait être acquise en une seule vie. Sa pensée se précise quand il parle de « l’évolution intérieure et profonde des forces et des âmes cherchant toutes dans l’infini le point d’où elles pourront le posséder ».
« Tous concourent à une fin idéale et jouent ainsi un rôle dans l’immense harmonie du tout. »
Jaurès a même une vague notion du périsprit, comme d’une forme antérieure et permanente de l’être, qu’on en juge plutôt : « L’homme futur n’existe pas en réduction et cependant il y a une forme caractéristique de la vie qui enveloppe et harmonise, avant même qu’elles se déploient, les qualités les plus diverses de la vie. »
Ainsi la philosophie de Jaurès aboutit à cette idée de l’unité universelle qui, transportée dans l’ordre social, deviendra la solidarité universelle. Jaurès ne négligeait pas de faire ressortir les conséquences funestes du matérialisme. Dans sa critique de cette théorie, il considérait comme un sophisme le fait de vouloir constater certaines conditions organiques à tout phénomène de conscience, et de vouloir ramener à ces conditions la conscience elle-même. »
Ailleurs, il décrit l’inquiétude et le vide dont souffre la pensée moderne : Il y a, à l’heure actuelle, comme un réveil de religiosité, on rencontre partout des âmes en peine cherchant une foi. On a besoin de croire, on est fatigué du vide du monde, du néant brutal de la science : on aspire à croire… Quoi ? Quelque chose, on ne sait, et il n’y a presque pas une de ces âmes souffrantes qui ait le courage de chercher la vérité, d’éprouver toutes ses conceptions et de se construire à elle-même, par un incessant labeur, la maison de repos et d’espérance. Aussi on ne voit que des âmes vides qui se penchent sur des âmes vides comme des miroirs sans objet qui se réfléchissent l’un l’autre. On supplée à la recherche par l’inquiétude, cela est plus facile et distingué… Quiconque n’a pas eu, une fois, besoin d’une foi, est une âme médiocre. »
L’éducation du peuple était un des grands soucis de Jaurès. S’adressant spécialement aux instituteurs dans la Dépêche de Toulouse du 15 janvier 1888, il écrivait : « Il faut montrer aux enfants la grandeur de la pensée, il faut leur enseigner le respect et le culte de l’âme en éveillant en eux le sentiment de l’infini qui est notre joie et aussi notre force, car c’est par lui que nous triompherons du mal, de l’obscurité et de la mort… Un jour, ils seront hommes, et il faut qu’ils sachent quelle est la racine de toutes nos misères : l’égoïsme aux formes multiples. »
Jaurès veut donner à chacun, par l’exercice de la faculté de penser, le sentiment de la valeur de l’homme » et, par là, inspirer à tous « le goût de la liberté sans laquelle l’homme n’est pas ». Déjà, dans sa thèse sur La Réalité du Monde sensible, on trouve cette phrase que nous offrons aux méditations des déterministes : « La vie, à travers toutes ses formes, n’en reste pas moins la vie avec son infinie liberté. » Et plus loin : La liberté se mêle à la nécessité comme le hasard à la loi. »
« Tout, chez Jaurès, dit son biographe, se ramène à l’interprétation idéaliste du monde, à un idéalisme supérieur fécond, idéalisme qui a pour point de départ la réalité totale, car l’idée elle-même, les forces idéales de l’humanité, les impondérables ne constituent pas moins un aspect de la réalité. Ainsi tous les problèmes s’éclairent d’une lumière d’en haut transcendante… Pour lui, le socialisme, ainsi que la démocratie, constituent un principe moral supérieur ».
On le voit par toutes les citations qui précèdent, la pensée de Jaurès, comme le vol de l’aigle, planait sur ces hauteurs dont l’enseignement des Esprits nous a ouvert l’accès. Sous des allusions à peine voilées, on y reconnaît les principes essentiels de leur doctrine : la notion des vies antérieures, l’évolution des âmes avec ses degrés, ses étapes innombrables et jusqu’à la prescience de cette forme subtile, permanente de l’homme que nous nommons le périsprit. Puis ce sont les perspectives de la vie infinie et la communion finale des êtres dans l’harmonie universelle. Jaurès ne voulait pas faire du socialisme simplement un ordre de choses qui ramène toutes les conditions de la vie à des questions d’intérêt matériel. Pour lui, le principe évolutif, qui est l’essence même du socialisme, est d’ordre moral. Il ne restait pas moins attaché au principe de liberté, et ne consentit jamais à sacrifier l’autonomie individuelle à la collectivité. « La domination d’une classe, disait-il aussi, est un attentat à l’humanité. » N’est-ce pas là, par anticipation, une répudiation des théories moscovites ? On le voit, ce qui distingue, par-dessus tout, la conception socialiste de Jaurès, c’est son caractère idéaliste. Il ne s’agit pas ici de cet idéalisme subjectif qui considère le monde extérieur comme une pure illusion des sens, mais de celui qui fait de l’idée, par conséquent de l’esprit, le principe essentiel de la vie et de l’évolution. Jaurès était avant tout tolérant et conciliateur ; il se complaisait à rechercher dans tous les systèmes, et même dans le matérialisme de Karl Marx, les points par lesquels ils pouvaient s’adapter à un spiritualisme rationnel. Dans ses analyses, il ne séparait pas la thèse de l’antithèse et, de là, il savait s’élever jusqu’à une synthèse qui embrassait toute chose dans une unité harmonieuse. Il faut lire, dans sa Réalité du Monde sensible, avec quelle puissance de dialectique et quelle hauteur de vues il commentait les théories des grands philosophes : Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, etc., sans parvenir cependant à dégager, des contradictions et des antinomies, la solution du grand problème. Il faut bien reconnaître que ces penseurs pèchent tous par le même côté : ils voient les choses d’en bas, c’est-à-dire du point de vue terrestre, forcément étroit et restreint, et ne peuvent, malgré l’élan de leur esprit, atteindre à la compréhension totale. Et c’est ici qu’éclate la supériorité de la doctrine des Esprits qui voient les choses d’en haut et embrassent la majestueuse unité des êtres et des lois. Du moins, Jaurès suppléait à cette faiblesse humaine par des intuitions géniales qui le préparaient à cette connaissance de l’univers invisible auquel il appartient aujourd’hui.
Certains critiques ont cherché à faire passer Jaurès pour un athée, pour un adversaire du sentiment religieux. Rien n’était plus faux. Le passage suivant d’un de ses articles dans la Dépêche de Toulouse, du 4 juillet 1892, dissipe sur ce point toute équivoque. On y lisait : « Je crois qu’il serait très fâcheux, qu’il serait mortel de comprimer les aspirations religieuses de la conscience humaine. Ce n’est point cela que nous voulons ; nous voulons, au contraire, que tous les hommes puissent s’élever à une conception religieuse de la vie, par la science, la raison et la liberté. Je ne crois pas du tout que la vie matérielle et sociale suffise à l’homme. Dès qu’il aura, dans l’ordre social, réalisé la justice, il s’apercevra qu’il lui reste un vide immense à remplir. Je n’hésite pas non plus à reconnaître que la conception chrétienne est une forme très haute du sentiment religieux, et je goûte médiocrement certaines facéties grossières sur le christianisme et sur les prêtres. » Et plus tard, dans un article sur Dieu, Jaurès précise magnifiquement sa pensée : « Tout ce que nous voulons dire aujourd’hui, c’est que l’idée religieuse, un moment effacé, peut rentrer dans les esprits et dans les consciences parce que les conclusions actuelles de la science les prédisposent à la recevoir. Il y a, dès maintenant, si l’on peut dire, une religion toute prête, et si elle ne pénètre point à cette heure les profondeurs de la société, si la bourgeoisie est platement spiritualiste ou niaisement positiviste, si le prolétariat est partagé entre la superstition servile ou un matérialisme farouche, c’est parce que le régime social actuel est un régime d’abrutissement et de haine, c’est-à-dire un régime irréligieux. Ce n’est point, comme le disent souvent les déclamateurs vulgaires et les moralistes sans idées, parce que notre société a le souci des intérêts matériels qu’elle est irréligieuse. Il y a au contraire quelque chose de religieux dans la conquête de la nature par l’homme, dans l’approbation des forces de l’univers aux besoins de l’humanité. Non, ce qui est irréligieux, c’est que l’homme ne conquiert la nature qu’en assujettissant les hommes. Ce n’est pas le souci du progrès matériel qui détourne l’homme des hautes pensées et de la méditation des choses divines, c’est l’épuisement du labeur inhumain qui ne laisse pas, à la plupart des hommes, la force de penser ni celles même de sentir la vie, c’est-à-dire Dieu. C’est aussi la surexcitation des passions mauvaises, la jalousie et l’orgueil, qui absorbent, dans des luttes impies, l’énergie intime des plus vaillants et des plus heureux. Entre la provocation de la faim et la surexcitation de la haine, l’humanité ne peut pas penser à l’infini. L’humanité est comme un grand arbre, tout bruissant de mouches irritées sous un ciel d’orage et, dans ce bourdonnement de haine, la voix profonde et divine de l’univers n’est plus entendue. »
LÉON DENISSource :
http://www.revue3emillenaire.com/blog/socialisme-et-spiritualite-par-leon-denis/